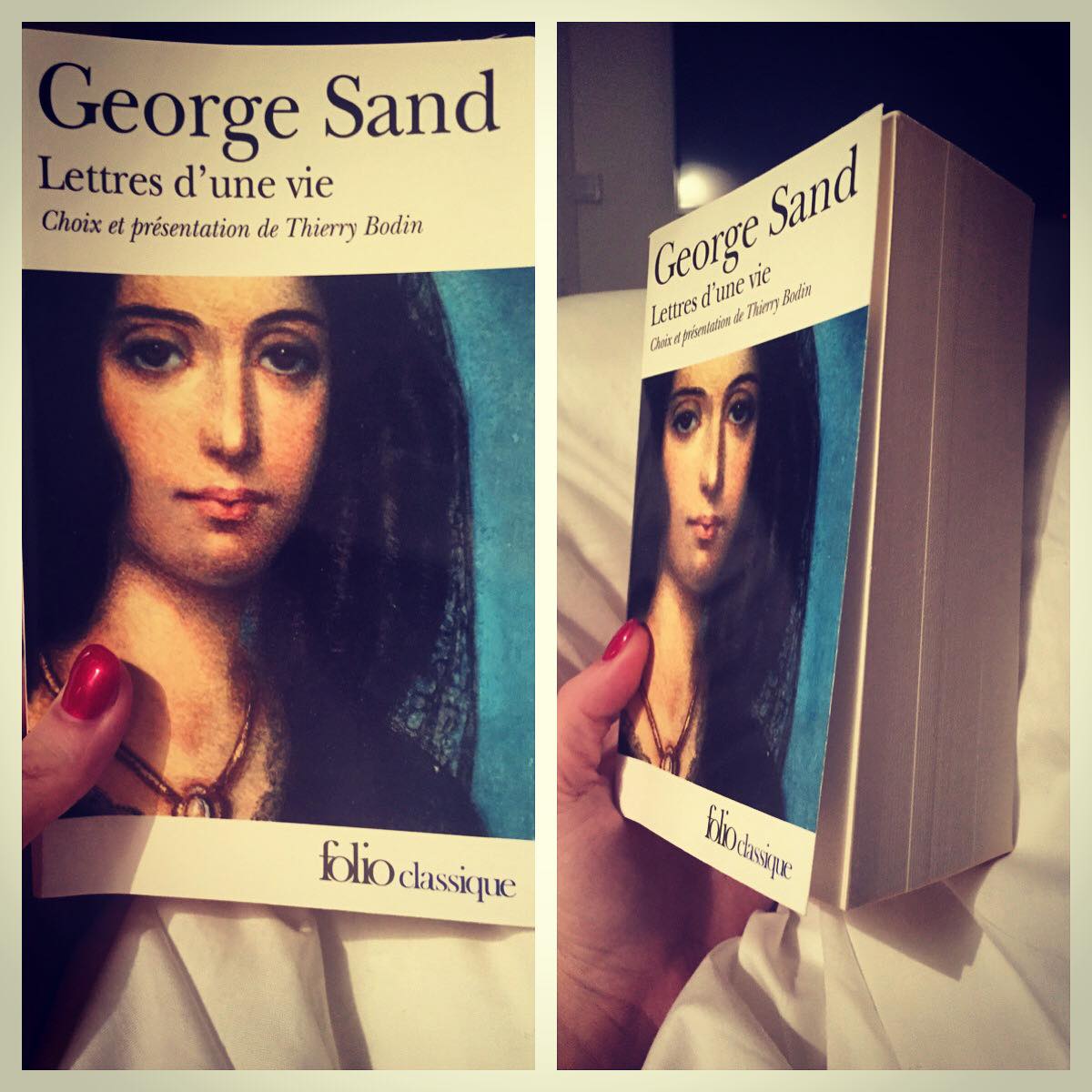Je viens de me procurer le livre « George Sand, Lettres d’une vie » : quatre cent trente-quatre lettres recensées dans cet ouvrage qui raconte cinquante ans d’une vie. Je vous le recommande, c’est assez incroyable d’entrer ainsi dans l’intimité d’un auteur (qui plus est, que l’on aime !). Voici une lettre que Sand a écrit à Alfred de Musset en 1834. Les deux éminents auteurs romantiques du 19ème siècle ont vécu deux ans d’amour aussi intenses que houleux. En 1833, les deux amants partent à Venise pour Noël. Musset passe alors ces nuits dans des maisons closes et des cabarets et finit par contracter une fièvre cérébrale. George Sand entretient une liaison avec le médecin de Musset, Pietro Pagello. Dans cette lettre, George Sand se livre entièrement à Alfred de Musset.
Non mon enfant chéri, ces trois lettres ne sont pas le dernier serrement de main de l’amante qui te quitte, c’est l’embrassement du frère qui te reste (1). Ce sentiment-là est trop beau, trop pur et trop doux pour que j’éprouve jamais le besoin d’en finir avec lui. Es-tu sûr, toi, mon petit, de n’être jamais forcé de le rompre ? Un nouvel amour ne te l’imposera-t-il pas comme une condition ? Que mon souvenir n’empoisonne aucune des jouissances de ta vie, mais ne laisse pas ces jouissances détruire et mépriser mon souvenir. Sois heureux, sois aimé. Comment ne le serais-tu pas ? Mais garde-moi dans un petit coin secret de ton cœur et descends-y dans tes jours de tristesse pour y trouver une consolation ou un encouragement. — Tu ne parles pas de ta santé. Cependant tu me dis que l’air du printemps et l’odeur des lilas entre dans ta chambre par bouffées et fait bondir ton cœur d’amour et de jeunesse. Cela est un signe de santé et de force, le plus doux certainement que la nature nous donne. Aime donc, mon Alfred, aime pour tout de bon. Aime une femme jeune, belle et qui n’ait pas encore aimé, pas encore souffert. Ménage-la et ne la fais pas souffrir. Le cœur d’une femme est une chose si délicate quand ce n’est pas un glaçon ou une pierre ! Je crois qu’il n’y a guère de milieu et il n’y en a pas non plus dans ta manière d’aimer et d’estimer. C’est en vain que tu cherches à te retrancher derrière la méfiance, ou que tu crois te mettre à l’abri par la légèreté de l’enfance. Ton âme est faite pour aimer ardemment ou pour se dessécher tout à fait. Je ne peux pas croire qu’avec tant de sève et de jeunesse, tu puisses tomber dans l’auguste permanence (2) . Tu en sortirais à chaque instant, et tu reporterais malgré toi sur des objets indignes de toi la riche effusion de ton amour. Tu l’as dit cent fois, et tu eu beau t’en dédire, rien n’a effacé cette sentence-là : Il n’y a au monde que l’amour qui soit quelque chose. Peut-être est-ce une faculté divine qui se perd et qui se retrouve, qu’il faut cultiver ou qu’il faut acheter par des souffrances cruelles, par des expériences douloureuses. Peut-être m’as-tu aimée avec peine pour aimer une autre avec abandon. Peut-être celle qui viendra t’aimera t-elle moins que moi, et peut-être sera-t-elle plus heureuse et plus aimée. Il y a de tels mystères dans ces choses et Dieu nous pousse dans des voies si neuves et si imprévues ! Laisse-toi faire, ne lui résiste pas. Il n’abandonne pas ses privilégiés. II les prend par la main et il les place au milieu des écueils où ils doivent apprendre à vivre, pour les faire asseoir ensuite au banquet où ils doivent se reposer. Moi, mon enfant, voilà que mon âme se calme et que l’espérance me vient. Mon imagination se meurt et ne s’attache plus qu’à des fictions littéraires. Elle abandonne son rôle dans la vie réelle et ne m’entraîne plus au delà de la prudence et du raisonnement. Mon cœur reste encore et restera toujours sensible et irritable, prêt à saigner abondamment au moindre coup d’épingle. Cette sensibilité a bien encore quelque chose d’exagéré et de maladif qui ne guérira pas en un jour. Mais je vois aussi la main de Dieu qui s’incline vers moi, et qui m’appelle vers une existence durable et calme. Tous les vrais biens, je les ai à ma disposition. Je m’étais habituée à l’enthousiasme et il me manque quelquefois ; mais quand l’accès de spleen est passé, je m’applaudis d’avoir appris à aimer les yeux ouverts. Un grand point pour hâter ma guérison, c’est que je puis cacher mes vieux restes de souffrances. Je n’ai pas affaire à des yeux aussi pénétrants que les tiens et je puis faire ma figure d’oiseau malade sans qu’on s’en aperçoive. Si on me soupçonne un peu de tristesse, je me justifie avec une douleur de tête ou un cor au pied. On ne m’a pas vue insouciante et folle. On ne connaît pas tous les recoins de mon caractère. On n’en voit que les lignes principales, cela est bien, n’est-ce pas ? — Et puis ici, je ne suis pas Mme Sand. Le brave Pierre n’a pas lu Lélia et je crois bien qu’il n’y comprendrait goutte. Il n’est pas en méfiance contre ces aberrations de nos têtes de poètes. Il me traite comme une femme de vingt ans et il me couronne d’étoiles comme une âme vierge. Je ne dis rien pour détruire ou pour entretenir son erreur, je me laisse régénérer par cette affection douce et honnête. Pour la première fois de ma vie j’aime sans passion.
Tu n’es pas encore arrivé là, toi. Peut être marcheras-tu en sens contraire. Peut être ton dernier amour sera-t-il le plus romanesque et le plus jeune. Mais ton cœur, ton bon cœur, ne le tue pas, je t’en prie! Qu’îl se mette tout entier ou en partie dans toutes les amours de ta vie, mais qu’il y joue toujours son rôle noble, afin qu’un jour tu puisses regarder en arrière et dire comme moi : j’ai souffert souvent, je me suis trompé quelques fois, mais j’ai aimé. C’est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui (3). J’ai essayé ce rôle dans les instants de solitude et de dégoût, mais c’était pour me consoler d’être seul, et quand j’étais deux, je m’abandonnais comme un enfant, je redevenais bête et bon comme l’amour veut qu’on soit.
Que tes lettres sont bonnes et tendres, mon cher Alfred ! La dernière est encore meilleure que les autres; ne t’accuse de rien, n’aie pas de remords, si tu ne peux surmonter certaines répugnances certaines tristesses. Ne hasarde rien qui te fasse souffrir. Tu as bien assez souffert pour moi. Ne vois pas mon fils si cela te fait mal. Si tu le vois, dis-lui qu’il ne m’a pas écrit depuis plus de deux mois et que cela me fait beaucoup de peine. — Je suis triste de n’avoir pas ma fille, et à présent que j’ai fixé que je ne devais pas la voir avant le mois d’août, je pense à elle nuit et jour avec une impatience et une soif incroyables. Qu’est-ce que c’est que cet amour des mères ? C’est encore une chose mystérieuse pour moi. Sollicitudes, inquiétudes cent fois plus vives que dans l’amour d’une amante et pourtant moins de joie et de transports dans la possession. Absence qui ne s’apercevait guère dans les premiers jours et qui devient cruelle et ardente comme la fièvre à mesure qu’elle se prolonge.
Je t’envoie une lettre pour Boucoiran, que je te prie de lui faire passer tout de suite. Je lui dis d’aller te voir. Charge-le de celles de mes affaires et de mes commissions qui t’ennuieront ou que tu n’auras pas le temps de faire. Je t’envoie la liste de ces commissions. Paye-toi avec l’argent que Buloz ou Salmon te remettront pour moi et dis-moi au juste où en sont mes affaires, si je puis faire payer mon loyer et surtout Sosthènes. Je crois que Buloz me doit encore 1500 francs sans compter la Lettre sur les Alpes que je t’ai envoyée et que je te supplie de ne pas lui donner si elle ne te plait pas.
— Je lui ai envoyé la fin d’André. Aie la bonté d’en corriger les épreuves, veux-tu, mon enfant ? Il y a deux choses à observer. D’abord que j’ai fait en plusieurs endroits de grosses bourdes à propos de l’âge de majorité. Il faut que tu t’assures de l’âge où un homme peut se marier sans le consentement des parents, et que tu fasses accorder les trois ou quatre passages où j’en parle. Il me semble que dans de certains endroits je lui donne vingt ans, et que six mois après il se trouve en avoir 25.
— Ensuite, il y a une grande portion de manuscrit, celle que tu as emportée, je crois, où j’ai oublié de faire la division des chapitres. Arrange cela et fais concorder les chiffres que j’ai laissés en blanc avec les précédens. Enfin, corrige les mots bêtes, les redites, les fautes de français. Tu sais que c’est un grand service à rendre à un auteur absent, que de le sauver de la bêtise des proies et de sa propre inadvertance. Jacques est en train et va au galop. Ce n’est l’histoire d’aucun de nous. Il m’est impossible de parler de moi dans un livre, dans la disposition d’esprit où je suis. — Pour toi, cher ange, fais ce que tu voudras, romans, sonnets, poèmes, parle de moi comme tu l’entendras, je me livre à toi, les yeux bandés. Je te remercierai à genoux des vers que tu m’enverras et de ceux que tu m’as envoyés. Tu sais que je les aime de passion, tes vers, et qu’ils m’ont appelée vers toi, malgré moi, d’un monde bien éloigné du tien.Mon oiseau est mort, et j’ai pleuré, et Pagello s’est mis à rire, et je me suis mise en colère, et il s’est mis à pleurer, et je me suis mise à rire. Voilà-t-il pas une belle histoire ? J’attends qu’il m’arrive quelques sous pour acheter une certaine tourterelle dont je suis éprise. Je ne me porte pas très bien. L’air de Venise est éminemment coliqueux et je vis dans des douleurs d’entrailles continuelles. J’ai été très occupée d’arranger notre petite maison, de coudre des rideaux, de planter des clous, de couvrir des chaises. C’est Pagello qui a fait à peu près tous les frais du mobilier, moi j’ai donné la main d’œuvre gratis, et son frère prétend, pour sa part, s’être acquitté en esprit et en bons mots. C’est un drôle de corps que ce Robert. Il a des façons de dire très comiques. L’autre jour il me priait de lui faire un rideau parce que lepopolo s’attroupait sur le pont quand il passait sa chemise. Au reste, je vis toujours sous la menace d’être assassinée par Mme Arpalice [Fanna]. Pagello s’est birouillé tout à fait avec elle. Giulia prend la chose au sérieux et vit pour moi dans des inquiétudes comiques. Elle me supplie de quitter le pays pour quelque tems parce qu’elle croit de bonne foi à une coltellata(4).
Voici les petits objets que je te prie de m’envoyer. Douze paires de gants glacés. — deux paires de souliers de satin noir et deux paires de maroquin noir, chez Michiels au coin de la rue Helder et du boulevard. Tu lui diras de les faire un peu plus larges que ma mesure : j’ai les pieds enflés et le maroquin de Venise est dur comme du buffle ; un quart de patchouly chez Leblanc, rue Sainte-Anne, en face le n°50 ; ne te fais pas attraper, cela vaut 2 francs le quart, Marquis le vend 6 f. — le cahier de nos romances espagnoles que Boucoiran prendra chez Paultre et te portera. — quelques cahiers de beau papier à lettres, il est impossible d’en trouver ici. — un paquet de journaux liés avec un cordon qui se trouve dans une de mes armoires de boule et que tu diras à Boucoiran de chercher. Ce sont les journaux qui ont parlé avantageusement d’Indiana et de Valentine. Pagello est en marché pour en vendre une traduction qu’il veut faire ; et il espère en tirer le double, s’il peut présenter à l’éditeur des journaux favorables. — N’oublie pas de joindre aux livres que je t’ai demandés la Marquise, Aldo le rimeur et Métella, parce qu’on demande une opérette (5) pour commencer la publication. Le romantique est fort à la mode ici. Aldo aurait, je crois, du succès. La Marquise aussi, parce qu’on est curieux à Venise des histoires singulières, stupides et folles. Je serais bien aise de faire gagner quelque million (de centimes) à Pagello avec mes œuvres légères. Je crois qu’il pourrait traduire aussi [Les Caprices de]Marianne, Fantasio ou Andréa. Je sais assez d’italien à présent pour l’aider à comprendre ta prose quoiqu’elle soit moins abordable que la mienne à un étranger. Il comprend très bien d’ailleurs le français imprimé et il écrit l’italien très remarquablement à ce qu’on dit. Je crois que tes petites comédies en prose feraient rage et cela m’amuserait de nous voir devenir célèbres à Venise. — Tu mettras toutes ces choses dans une caisse avec les livres (tout cela peut voyager ensemble sans inconvénient) et je te prie de mettre la caisse à la diligence à l’adresse de Pagello, Farmacia Ancillo, à Venise — cela suffit et Pagello se charge de tout. — Adieu, mon cher petit ange, écris-moi, écris-moi toujours des ces bonnes lettres qui ferment toutes les plaies que nous nous sommes faites et qui changent en joies présentes nos douleurs passées. Je t’embrasse […] pour moi et pour le docteur.
Ecris-moi à la farmacia Ancillo, c’est le plus prompt moyen d’avoir tes lettres dès le matin.
Tu as [ligne coupée] sent-il aussi mauvais que par le passé ? As-tu entrevu le gigantesque col de chemise ? Quelquefois je me mets à rire toute seule au souvenir de nos bêtises et puis il se trouve que cela me fait pleurer. Oh! nous nous reverrons, n’est-ce pas ?
(1) : Réponse à la lettre de Musset du 30 avril : » ces trois lettres que j’ai reçues, est-ce le dernier serrement de main de la maîtresse qui me quitte, ou le premier de l’amie qui me reste ?
(2) : Une note de G. Sand, reproduite dans la première édition de la correspondance Musset-Sand (Félix Decori, 1904), explique : « C’est un mot que Gustave Planche employait souvent et avec lequel elle le taquinait parfois.
(3) : Musset a repris littéralement cette phrase dans On ne badine pas avec l’amour (II, 5)
(4) : Coup de couteau
(5) : Un petit ouvrage
(Source : George Sand Lettres d’une vie (choix et présentation de Thierry Bodin) Folio Classique)